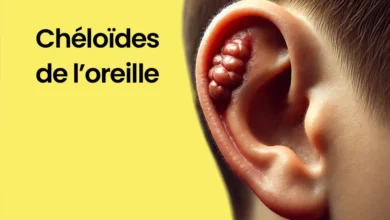Surdité soudaine : premiers gestes, traitements urgents et pronostic

La perte subite de l’audition dans une oreille est une expérience aussi déroutante qu’inquiétante. Cette surdité soudaine, dite aussi surdité brusque ou hypoacousie brutale, constitue une urgence médicale ORL qu’il faut prendre très au sérieux. Heureusement, avec une prise en charge rapide et appropriée, il est possible dans de nombreux cas de récupérer tout ou partie de son audition. Dans cet article, nous expliquons ce qu’est la surdité soudaine, comment la reconnaître, que faire en urgence, quels sont les traitements disponibles et quelles sont les chances de récupération (pronostic).
Qu’est-ce que la surdité soudaine ?
La surdité soudaine se caractérise par une perte auditive brutale survenue en l’espace de quelques secondes ou en quelques heures, touchant généralement une seule oreille (surdité unilatérale) sans cause évidente initiale. En d’autres termes, la personne constate qu’elle n’entend plus ou beaucoup moins bien d’une oreille, comme si celle-ci était subitement bouchée. Cette perte auditive rapide et inexpliquée concerne l’oreille interne (surdité de perception) : elle n’est pas due à un bouchon de cérumen, une otite ou un tympan percé, mais à une atteinte des structures délicates de l’oreille interne (cochlée, cellules sensorielles) ou du nerf auditif. On la définit classiquement par une baisse d’au moins 30 décibels sur trois fréquences audiométriques consécutives, survenue en moins de 72 heures.
Bien que relativement rare, la surdité brusque peut toucher tous les adultes, hommes et femmes à parts égales, le plus souvent entre 50 et 60 ans. Dans plus de 95 % des cas, elle n’affecte qu’une oreille (gauche ou droite) – une surdité touchant les deux oreilles en même temps est exceptionnelle. Cette condition est aussi appelée surdité neurosensorielle soudaine (ou surdité subite idiopathique lorsque aucune cause n’est identifiée). Le principal message à retenir est que la surdité soudaine constitue une urgence médicale : il faut la reconnaître et la traiter sans tarder pour avoir les meilleures chances de récupérer l’audition.
Quels sont les symptômes d’une surdité soudaine ?
Le symptôme principal est, bien sûr, une perte auditive brutale. Voici les signes qui doivent alerter :
- Diminution soudaine de l’audition d’une oreille (perte partielle ou parfois totale). Cette baisse peut être remarquée au réveil ou survenir en cours de journée, donnant l’impression que l’oreille s’est “éteinte” d’un coup.
- Sensation d’oreille bouchée ou de pression dans l’oreille concernée. Beaucoup de patients comparent la sensation à celle d’un bouchon de cérumen ou d’une eau qui obstrue l’oreille, alors qu’aucune cause externe n’est retrouvée.
- Acouphènes dans l’oreille atteinte, c’est-à-dire des bourdonnements, sifflements ou tintements survenant en même temps que la perte auditive. Ces bruits parasites sont présents dans la majorité des cas et accentuent l’inconfort.
- Vertiges ou déséquilibres dans environ 30 à 40 % des cas. Ce n’est pas systématique, mais une surdité brusque peut s’accompagner de vertige ou d’une impression de tête qui tourne, signe que l’oreille interne (qui gère aussi l’équilibre) est perturbée.
- Difficulté à comprendre les conversations, surtout en environnement bruyant, en raison de la perte de l’ouïe d’un côté. Il peut devenir ardu de localiser les sons (on n’entend plus que d’une oreille) et de suivre une discussion dans le bruit.
En revanche, la surdité soudaine ne s’accompagne généralement pas de douleur dans l’oreille. Si des douleurs ou de la fièvre sont présentes, il s’agit plutôt d’une otite ou d’un autre problème (ce qui nécessite aussi de consulter, mais c’est différent). À noter que dans de rares cas, certains signes particuliers peuvent accompagner la surdité brusque : par exemple une paralysie faciale et des petites vésicules douloureuses sur l’oreille peuvent révéler un zona de l’oreille interne (syndrome de Ramsay Hunt), ou encore des maux de tête intenses pourraient orienter vers un problème vasculaire. Ces cas restent peu fréquents, mais tout symptôme inhabituel associé à une perte auditive soudaine doit être signalé au médecin.
Quelles sont les causes possibles d’une surdité soudaine?
Dans la majorité des cas (environ 9 cas sur 10), aucune cause évidente n’est identifiée initialement : on parle alors de surdité brusque idiopathique. Les médecins supposent généralement que ce type de surdité soudaine pourrait être lié à un problème circulatoire ou viral touchant l’oreille interne. En effet, deux hypothèses principales sont souvent évoquées pour expliquer ces surdités idiopathiques :
- Une cause vasculaire : une interruption ou diminution brutale de la circulation sanguine vers la cochlée (organe de l’audition) pourrait priver les cellules auditives d’oxygène et provoquer leur dysfonctionnement. Un spasme, un petit caillot (thrombose) ou une hémorragie dans l’artère irriguant l’oreille interne sont des mécanismes possibles. Ce type de « micro-AVC » de l’oreille explique que la surdité survienne soudainement (accident vasculaire cochléaire).
- Une cause infectieuse virale : certains virus pourraient endommager subitement l’oreille interne. Les virus de l’herpès (HSV-1), du zona, les oreillons, la grippe ou d’autres virus ORL sont suspectés d’attaquer les cellules de la cochlée ou le nerf auditif chez certaines personnes. L’inflammation causée par l’infection peut alors détériorer les structures de l’oreille interne et conduire à une perte auditive soudaine. (À noter qu’en 90 % des cas aucune preuve directe n’est trouvée, ce sont des hypothèses.)
En dehors de ces formes idiopathiques, environ 10 % des surdités brusques sont secondaires à une cause identifiée. Parmi les causes possibles de surdité soudaine, on peut citer :
- Un neurinome de l’acoustique (aussi appelé schwannome vestibulaire) : il s’agit d’une tumeur bénigne du nerf auditif. Bien que cette tumeur provoque le plus souvent une surdité progressive, elle peut dans de rares cas entraîner une perte auditive brutale en irritant le nerf cochléaire. On estime que moins de 5 % des surdités brusques sont dues à un neurinome de l’acoustique, mais il est essentiel d’y penser et de le rechercher par un examen IRM systématique en cas de surdité soudaine (voir plus loin).
- Des maladies auto-immunes : certaines pathologies auto-immunes où le système immunitaire attaque l’oreille interne peuvent provoquer des surdités soudaines récurrentes. Par exemple, la sarcoïdose, le lupus ou la granulomatose de Wegener figurent parmi les maladies pouvant toucher l’audition. Ces patients présentent souvent des pertes auditives fluctuantes, pouvant toucher les deux oreilles tour à tour.
- La maladie de Ménière : il s’agit d’une affection de l’oreille interne caractérisée par des hydrops (excès de pression du liquide dans la cochlée). Elle provoque classiquement des crises de vertige avec baisse d’audition et acouphènes. Parfois, la première manifestation d’une maladie de Ménière peut être une surdité brusque (souvent sur les basses fréquences, et susceptible de récidiver).
- Un traumatisme ou choc sur l’oreille : un traumatisme crânien violent (accident, chute) peut endommager l’oreille interne en provoquant une fracture de l’os temporal ou une commotion labyrinthique, entraînant une perte auditive soudaine. De même, une exposition à un bruit extrêmement intense (explosion, coup de feu) peut causer une destruction brutale des cellules ciliées de la cochlée – c’est le traumatisme sonore aigu. Les changements de pression importants (par exemple en plongée sous-marine ou lors d’une décompression trop rapide en avion) sont un autre facteur de risque : ils peuvent provoquer une fistule périlymphatique, c’est-à-dire une déchirure entre l’oreille interne et moyenne qui entraîne une fuite de liquide et une surdité soudaine.
- Certains médicaments ototoxiques : la prise de médicaments toxiques pour l’oreille (certains antibiotiques aminosides à forte dose, chimiothérapies, etc.) peut exceptionnellement déclencher une perte auditive rapide. Ce type de surdité brusque d’origine toxique est rare et dépend d’une susceptibilité individuelle.
- Autres causes neurologiques : plus rarement, une surdité brusque peut révéler une maladie neurologique sous-jacente. Par exemple, elle a été observée au cours de la sclérose en plaques (lors d’une poussée inflammatoire touchant le nerf auditif central) ou lors d’un accident vasculaire cérébral impliquant l’artère auditive interne. Ces causes sont très atypiques, mais devant une surdité unilatérale soudaine inexpliquée, un bilan complet incluant une IRM cérébrale est préconisé pour éliminer ces diagnostics graves.
En résumé, dans la plupart des cas aucune cause précise n’est retrouvée : on attribue la surdité brusque à un incident vasculaire ou viral touchant l’oreille interne. Néanmoins, le médecin ORL devra évaluer le patient et éventuellement réaliser des examens (audiogramme, IRM…) pour déterminer la cause ou écarter les causes graves (comme un neurinome, un AVC).
Surdité soudaine : que faire en cas d’apparition des symptômes ?

Face à une perte auditive brutale, la rapidité de réaction est cruciale. Les premiers gestes à adopter se résument essentiellement à consulter en urgence : il ne faut surtout pas attendre pour voir si ça passe tout seul. Voici les réflexes à avoir :
- Consultez immédiatement un professionnel de santé. Idéalement, il faut joindre sans délai un médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste) ou se rendre aux urgences hospitalières (de préférence dans un service ORL s’il en existe). Précisez que vous présentez une perte auditive soudaine, afin d’être orienté rapidement. La survenue brutale d’une surdité, souvent unilatérale et sans cause apparente, nécessite un avis médical urgent. Le médecin confirmera s’il s’agit bien d’une surdité brusque neurosensorielle et initiera le traitement en urgence.
- Ne pas confondre avec un simple « bouchon ». Au début, on pourrait penser à une cause banale (bouchon de cérumen, eau dans l’oreille…). N’essayez pas de “nettoyer” l’oreille vous-même avec un coton-tige ou des gouttes sans avis médical – cela pourrait aggraver la situation ou faire perdre un temps précieux. Seule une évaluation par un médecin pourra faire la différence entre une obstruction bénigne du conduit auditif et une vraie surdité de perception. Il est arrivé que des patients perdent de précieuses journées en pensant avoir simplement l’oreille bouchée, retardant ainsi le traitement urgent requis.
- Faire un bilan auditif en urgence. Le médecin réalisera un examen clinique : otoscopie (pour vérifier le conduit auditif et le tympan) et tests auditifs. Un audiogramme tonal complet sera fait en urgence pour mesurer l’ampleur de la perte auditive sur chaque oreille. Cet examen est indispensable pour confirmer le diagnostic de surdité brusque et évaluer la sévérité (atteinte de quelles fréquences, quel niveau de décibels de perte). Des tests d’équilibre pourront être ajoutés si vous signalez des vertiges.
- Examens complémentaires. Selon le contexte, un examen IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau et des conduits auditifs internes sera prescrit, généralement après l’initiation du traitement d’urgence (il peut être réalisé dans les jours qui suivent, sans retarder la thérapie). L’IRM sert à rechercher une cause spécifique : un neurinome de l’acoustique, une atteinte vasculaire cérébrale, une sclérose en plaques, etc. C’est un passage obligé pour ne pas méconnaître une étiologie grave, même si dans 90 % des cas l’IRM revient normale.
En résumé : en cas de perte d’audition soudaine, ne restez pas chez vous à attendre. Plus le délai entre l’apparition des symptômes et la prise en charge est court, meilleures sont les chances de récupération. Si vous n’avez pas d’ORL disponible immédiatement, allez aux urgences générales : il vaut mieux consulter “pour rien” que de risquer une surdité définitive en tardant. Passé un certain délai (quelques semaines), le traitement n’est plus efficace, d’où l’importance d’une prise en charge rapide (idéalement dans les 48–72 heures suivant la perte auditive).
Quels sont les traitements d’urgence de la surdité soudaine ?

Le traitement de première intention d’une surdité brusque consiste à administrer des corticoïdes (corticothérapie) le plus rapidement possible. Ce sont des médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens qui vont aider à réduire l’œdème et l’inflammation dans l’oreille interne, favorisant ainsi la récupération de l’audition. Les corticoïdes sont le seul traitement ayant démontré un bénéfice significatif dans cette indication, c’est pourquoi les spécialistes les prescrivent d’emblée.
- Corticothérapie systémique (orale ou injectable) : Souvent, on administre de fortes doses de corticoïdes par voie orale (par exemple de la prednisone en comprimés) pendant une durée de 7 à 14 jours environ. La posologie est élevée au début puis généralement diminuée progressivement (tapering). Ces corticoïdes doivent être débutés idéalement dans les 10 à 15 premiers jours après la surdité – plus on les commence tôt, plus ils ont de chances d’être efficaces. Ils agissent en réduisant l’inflammation, en diminuant l’œdème et peut-être en améliorant la micro-circulation dans la cochlée. Dans certains cas, une injection de corticoïdes directement dans l’oreille moyenne (injection intra-tympanique) est réalisée par l’ORL : soit d’emblée si la voie orale est contre-indiquée, soit en deuxième intention si le traitement oral n’a pas donné suffisamment de résultats. L’injection locale permet de baigner l’oreille interne de médicament en contournant la barrière sang-oreille, et peut être proposée jusqu’à 4 à 6 semaines après l’apparition des symptômes (au-delà, même les injections ne sont plus recommandées).
- Oxygénothérapie hyperbare : Il s’agit d’un traitement consistant à faire respirer de l’oxygène pur dans une chambre à haute pression, afin d’augmenter l’oxygénation du sang et des tissus de l’oreille interne. L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) n’est pas disponible partout et son utilisation reste discutée, mais certaines études indiquent qu’elle peut améliorer la récupération auditive, surtout en association avec la corticothérapie. Les recommandations américaines conseillent d’envisager l’OHB dans les 3 mois suivant le diagnostic de surdité brusque idiopathique, en complément des corticoïdes. En pratique, l’OHB est surtout proposée pour les surdités brusques sévères ou profondes et si possible initiée tôt (dans les premiers jours ou semaines). C’est un traitement contraignant (séances quotidiennes en caisson hyperbare pendant 1 à 2 heures sur plusieurs jours) mais qui peut apporter un plus dans certains cas.
- Autres traitements médicamenteux : Dans le passé, de nombreux médicaments ont été essayés pour traiter la surdité brusque : vasodilatateurs (pour augmenter le flux sanguin cochléaire), antiviraux (ciblant le virus de l’herpès), anticoagulants, vitamines, anti-inflammatoires non stéroïdiens, etc. Cependant, les études n’ont pas montré de bénéfice convaincant de ces traitements complémentaires. Les recommandations récentes ne préconisent pas l’usage systématique d’antiviraux ni de médicaments vasoactifs, du moins pas tant qu’une cause infectieuse spécifique n’est pas prouvée. En clair, le traitement standard repose sur les corticoïdes, et les autres traitements sont au cas par cas selon le contexte (par exemple, on prescrira un antiviral si l’on suspecte fortement une infection par le zona otitique, ou un vasodilatateur s’il existe un trouble vasculaire associé, mais ce n’est pas systématique).
- Traitement étiologique si cause identifiée : Lorsque la surdité brusque est le symptôme d’une maladie sous-jacente, il faut bien sûr traiter cette dernière. Par exemple, en cas de maladie de Ménière, un traitement de fond (régime pauvre en sel, diurétiques, bétahistine) sera mis en place pour prévenir de nouveaux épisodes. Si la cause est une maladie auto-immune, des immunosuppresseurs (corticoïdes au long cours, méthotrexate…) pourront être nécessaires. En cas de neurinome de l’acoustique diagnostiqué à l’IRM, le patient sera orienté vers un neurochirurgien ou un centre spécialisé pour discuter des options (surveillance, chirurgie ou radiothérapie stéréotaxique) – toutefois, on insiste sur le fait qu’un neurinome provoque rarement une surdité brutale bilatérale, et que traiter la tumeur n’entraînera pas forcément la récupération de l’audition perdue. Si un AVC de l’artère auditive interne est diagnostiqué, la prise en charge neurologique (thrombolyse, aspirine…) devra être effectuée en urgence, mais là encore la récupération auditive est incertaine.
- Appareillage auditif en cas de séquelles : Malgré tous les traitements, il arrive qu’une partie de l’audition ne revienne pas. Si une surdité permanente persiste sur l’oreille atteinte, des solutions existent pour améliorer le confort du patient. Une prothèse auditive (aide auditive) adaptée par un audioprothésiste pourra amplifier les sons du côté sourd. Ce type d’appareillage est indiqué si l’oreille atteinte garde un reste d’audition exploitable. En cas de surdité totale unilatérale (une oreille entendante, l’autre zéro), des dispositifs spécifiques comme les systèmes à conduction osseuse (BAHA) ou les systèmes CROS peuvent router le son du côté sourd vers l’oreille entendante. Rarement, on peut envisager un implant cochléaire dans l’oreille sourde si la surdité est profonde et invalidante, notamment chez les patients plus jeunes ou en cas de besoin professionnel (certaines équipes proposent l’implant cochléaire pour surdité unilatérale sévère). Quoi qu’il en soit, l’audioprothèse fait partie intégrante de la prise en charge si la récupération auditive est incomplète, afin de permettre au patient de retrouver la meilleure audition possible dans sa vie quotidienne.
À noter que la surdité brusque est souvent associée à des acouphènes persistants. Si les bourdonnements d’oreille continuent après l’épisode, des traitements spécifiques (médicamenteux ou audiothérapies) pourront être proposés pour les atténuer, en plus de l’appareillage auditif. Un suivi régulier avec audiogrammes de contrôle dans les mois qui suivent est également recommandé pour suivre l’évolution de l’audition.
Pronostic : quelles sont les chances de récupération auditive ?
Entendre à nouveau après une surdité brusque est possible, et fort heureusement le pronostic est souvent favorable. Environ deux tiers des patients récupèrent une part significative de leur audition après une surdité soudaine. Cela inclut les récupérations complètes (retour à une audition normale) et les récupérations partielles (amélioration notable de l’audition même si ce n’est pas à 100 %). Malheureusement, cela signifie qu’environ un tiers des patients garderont une perte auditive importante ou totale sur l’oreille atteinte malgré le traitement. Chaque cas est individuel, et il est difficile de prédire à l’avance l’évolution pour une personne donnée, mais plusieurs éléments permettent d’affiner le pronostic :
- Délai de traitement : C’est le facteur pronostique majeur. Plus le traitement par corticoïdes est initié tôt, meilleures sont les chances de récupération. Idéalement, il devrait débuter en quelques jours : si on commence sous 24-48h, les taux de récupération sont bien plus élevés qu’en cas de traitement démarré au bout de 2 ou 3 semaines. Passé 6 semaines sans traitement, les atteintes auditives installées deviennent en principe définitives. C’est pourquoi il ne faut pas attendre.
- Sévérité et profil de la perte auditive : Le pronostic est d’autant meilleur que la perte d’audition initiale est peu profonde et ciblée sur certaines fréquences. Par exemple, une surdité brusque touchant uniquement les hautes fréquences ou les basses fréquences récupère plus volontiers qu’une perte massive affectant toutes les fréquences. De même, si la surdité n’est pas totale (une audition résiduelle subsiste), les chances de récupération partielle sont plus élevées. En revanche, une surdité brutale complète sur toutes les fréquences, surtout si elle s’accompagne de vertiges importants, est un signe de lésion plus sévère de l’oreille interne et le pronostic auditif est plus réservé.
- Présence de symptômes associés : On observe que les patients ayant de forts vertiges lors de la surdité soudaine ont en général une atteinte plus grave (le vestibule est touché en plus de la cochlée), ce qui est associé à un taux de récupération plus faible. En revanche, la présence d’acouphènes n’est pas un facteur prédictif fiable de récupération (ils sont fréquents quel que soit le degré de récupération). Des symptômes neurologiques (comme une paralysie faciale, des maux de tête atypiques) orientent vers d’autres causes et un pronostic dépendant de la pathologie en question.
- Âge et état de santé du patient : Un patient jeune et globalement en bonne santé (pas de troubles cardiovasculaires, diabète équilibré, etc.) a un pronostic légèrement meilleur, car ses capacités de récupération cellulaires sont en théorie supérieures. Avoir des facteurs de risque cardio-vasculaires (hypertension, cholestérol, tabagisme) peut être associé à un risque accru de surdité brusque et possiblement à une moindre récupération, surtout si la cause est vasculaire. Quoi qu’il en soit, même un patient plus âgé peut récupérer s’il est traité rapidement, donc personne n’est exclu d’une possible amélioration.
Il est intéressant de noter que des récupérations spontanées (sans traitement) peuvent se produire dans un certain nombre de cas. Les estimations varient, mais on considère qu’autour de 50 à 60 % des surdités brusques idiopathiques pourraient récupérer spontanément au moins partiellement. Cependant, il est impossible de savoir à l’avance qui récupérera spontanément et qui restera sourd. Or, si on se contente d’attendre sans rien faire et que la récupération spontanée n’a pas lieu, il sera trop tard pour agir ensuite. C’est pourquoi les médecins préfèrent traiter activement avec des corticoïdes dès le diagnostic, afin de mettre toutes les chances du côté du patient.
La bonne nouvelle est que, avec un traitement précoce, jusqu’à deux patients sur trois récupèrent une audition satisfaisante. Souvent, les premières améliorations surviennent dans les jours ou semaines suivant le début du traitement. La majorité des patients qui récupèrent voient une nette amélioration en l’espace de 10 à 15 jours après l’épisode. Parfois la récupération continue de s’affiner sur plusieurs semaines. Des contrôles audiométriques réguliers permettront de suivre l’évolution.
Si malheureusement aucune amélioration n’est obtenue malgré le traitement (surdité permanente), il faut se faire à l’idée de vivre avec une seule oreille fonctionnelle. C’est ce qu’on appelle la surdité unilatérale. Cela nécessite quelques adaptations (se placer du bon côté pour écouter, faire attention dans la rue car la localisation des sons est réduite, etc.), mais des solutions existent – comme évoqué plus haut, le port d’un appareil auditif adapté ou d’un système auditif spécial – pour améliorer le confort. Un soutien psychologique peut aussi être proposé, car perdre subitement l’audition d’une oreille peut être éprouvant moralement. Avec le temps et les aides techniques, on apprend à compenser cette gêne au quotidien.
Peut-on prévenir la surdité brusque ?
Dans la plupart des cas, on ne peut pas prévenir avec certitude une surdité soudaine idiopathique, puisqu’elle survient de façon imprévisible et souvent sans cause connue. Néanmoins, quelques conseils de bon sens peuvent aider à réduire les risques de problèmes auditifs en général :
- Protéger ses oreilles du bruit : Évitez l’exposition à des bruits très intenses sans protection (concerts à haut volume, usage prolongé d’écouteurs à volume élevé, outils bruyants). Les traumatismes sonores aigus peuvent provoquer des surdités brusques, il est donc important de porter des bouchons d’oreille ou un casque antibruit dans les environnements à risque.
- Éviter les variations de pression brutales : Si vous pratiquez la plongée sous-marine ou si vous prenez souvent l’avion, apprenez les manœuvres de compensation (Valsalva, etc.) et respectez les paliers de décompression pour les plongeurs. Ne plongez pas si vous avez une sinusite ou une otite. Les surdités brusques par barotraumatismes sont rares mais potentiellement évitables avec ces précautions.
- Surveiller sa santé cardiovasculaire : Les troubles de la circulation sanguine pouvant jouer un rôle, il est recommandé de traiter correctement une hypertension artérielle, un diabète, un cholestérol élevé, etc. Un mode de vie sain (alimentation équilibrée, activité physique, arrêt du tabac) contribue à une meilleure santé vasculaire et peut prévenir certains problèmes auditifs d’origine vasculaire.
- Éviter l’automédication ototoxique : Ne prenez pas de médicaments connus pour être toxiques pour l’oreille (médicaments ototoxiques comme certains antibiotiques, anticancéreux, fortes doses d’aspirine…) sans suivi médical. Respectez toujours les doses prescrites par le médecin. En cas de traitement potentiellement ototoxique, un suivi de l’audition sera mis en place.
- Consulter rapidement en cas de symptôme ORL anormal : Enfin, la meilleure prévention secondaire est d’agir vite. Si un jour vous ressentez une baisse d’audition, des acouphènes ou des vertiges inexpliqués, consultez sans tarder. Que ce soit une surdité brusque ou une autre affection de l’oreille, une prise en charge rapide évitera des aggravations. Par exemple, traiter une otite sévère à temps peut éviter qu’elle n’endommage l’oreille interne, etc. De même, la vaccination contre certaines infections (oreillons, méningite) protège indirectement contre les surdités qu’elles pourraient causer.
Il n’y a pas de recette miracle pour empêcher totalement les surdités brusques, mais adopter ces bonnes pratiques contribue à une meilleure santé auditive et peut réduire certains risques.
Conclusion
La surdité soudaine est un événement impressionnant, mais ce n’est pas une fatalité. Le maître-mot est : agir vite. Si vous ou un proche perdez l’audition d’une oreille du jour au lendemain, considérez que c’est une urgence médicale et consultez immédiatement un spécialiste. Un bilan audiologique permettra de poser le diagnostic, d’écarter les causes curables (par exemple un bouchon, une otite) et de débuter sans attendre le traitement approprié (généralement à base de corticoïdes). Plus le traitement est instauré tôt, plus les chances de récupération auditive sont élevées. Dans de nombreux cas – environ les deux tiers – l’audition revient totalement ou partiellement, souvent en l’espace de quelques jours à quelques semaines. Même si une partie de l’audition est perdue de façon permanente, il existe des solutions d’appareillage auditif et de rééducation pour vous aider à surmonter ce handicap et à continuer à vivre pleinement.
En somme, la surdité brusque constitue une urgence ORL qu’il ne faut jamais ignorer. Retenez bien les symptômes (perte auditive unilatérale, oreille bouchée, acouphènes, etc.) et les premiers gestes (consulter en urgence un médecin) afin de réagir au mieux si cela survient. Grâce aux traitements modernes et à une prise en charge rapide, les chances de récupération sont réelles et souvent encourageantes. N’hésitez pas à en parler immédiatement à un professionnel de santé si cela vous arrive – chaque heure compte, mais l’espoir de retrouver l’ouïe est bien là.